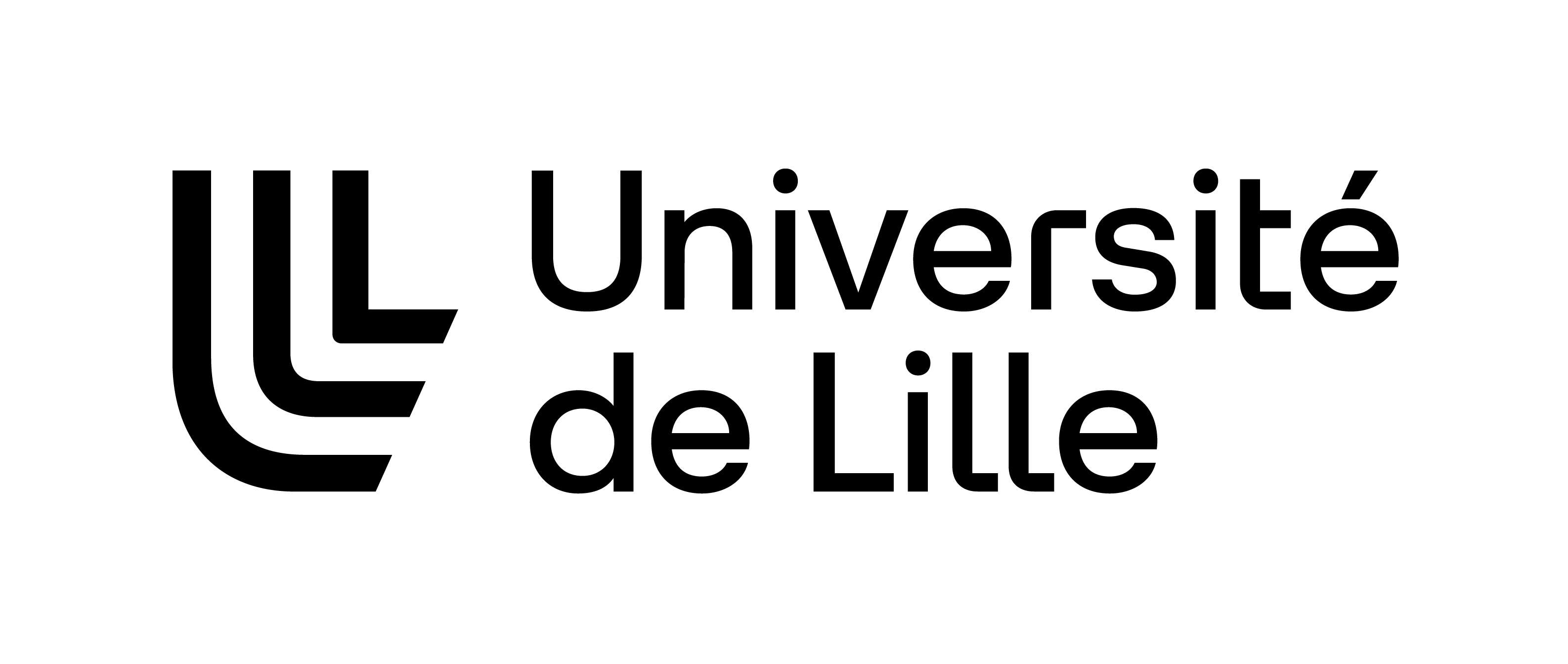LE COMTE DE MONTE-CRISTO
Mois des personnels
Cinéma
Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière, 2024, 2h58, tout public